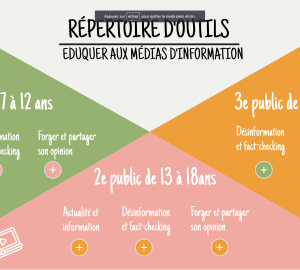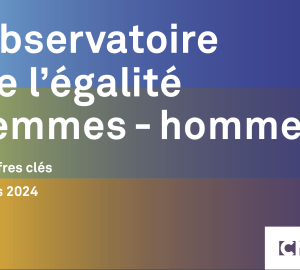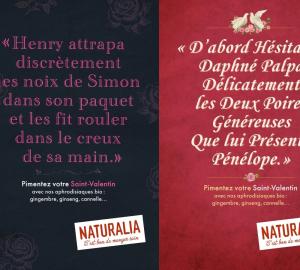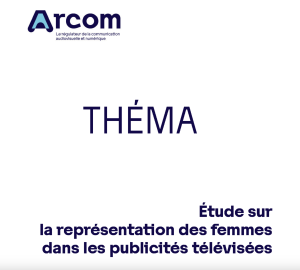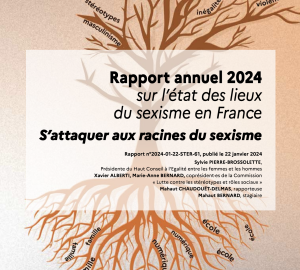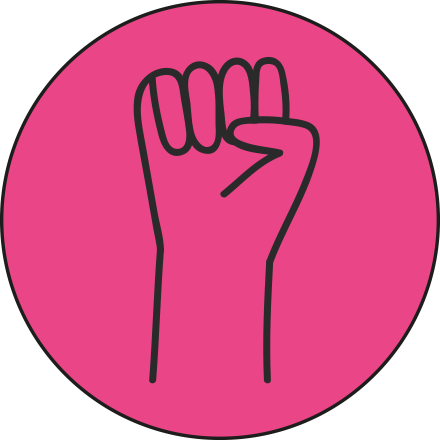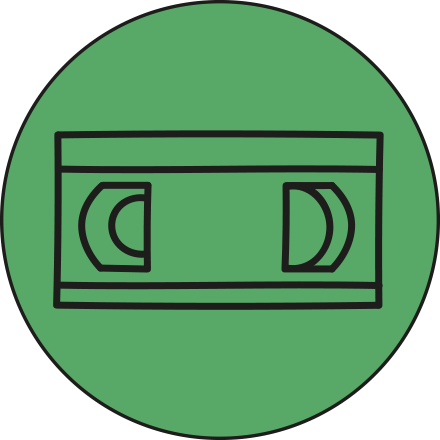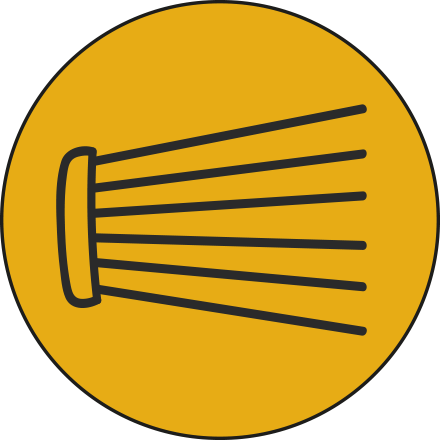Des ressources et des ateliers pour analyser les représentations sexuées et les stéréotypes de genre dans l'image

Un site édité par le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir
Genrimages, un site qui croise éducation à l'image et éducation à l'égalité

ACCÉDER à des ressources gratuites par thèmes et par niveaux
Séquences pédagogiques, images et vidéos analysées, entretiens, courts métrages, rapports...
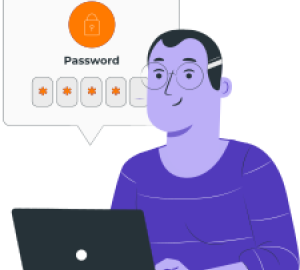
OUVRIR un compte pour conserver vos recherches et annoter des images
Possibilité supplémentaire d’initier un travail à distance via l’espace enseignant.
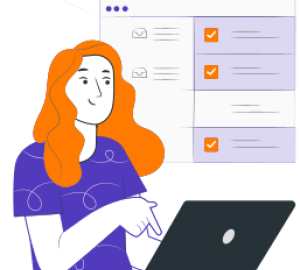
ORGANISER des ateliers et des formations dans votre structure
Nous nous déplaçons pour vous aider à organiser des ateliers et des projections-débats, ajustés à vos attentes pédagogiques, et des formations pour adultes à la carte pour se saisir des outils Genrimages.